I- L'épreuve de présentation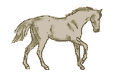
II- POR : parcours d'orientation et de régularité
III- Maîtrise des allures : du dressage en ligne droite
IV- PTV : parcours en terrain varié
V- Choix du cheval de TREC
I- L'épreuve de présentation
Lâché en pleine nature pour des parcours qui peuvent dépasser 50 km, le trecquiste doit être autonome et parfaitement équipé. L'épreuve de présentation est destinée à vérifier que le couple est prêt pour le grand départ. Notée sur 10, cette épreuve a peu d'incidence sur le classement. Son rôle consiste plutôt à vérifier que les cavaliers sont parés pour leur expédition et qu'ils peuvent prendre le départ.
C'est au début du POR que s'accomplissent
les vérifications, environ un quart d'heure avant l'entrée dans la salle des cartes. Après
une vérification extérieure du cheval et de son harnachement,
le cavalier est invité à montrer ce qu'il emporte dans ses
poches et dans ses sacoches. Il est important de bien connaître l'emplacement
de chaque objet et de prévoir des trousses (secourisme, maréchalerie)
faciles à ouvrir, à refermer et à ranger sous peine
de se retrouver avec un étalage hétéroclite sous les
bras avant le départ.
Le jury commence par s'assurer que le cheval n'aura pas à souffrir de la longue journée qui s'annonce : est-il parfaitement pansé, les pieds sont-ils curés, la ferrure est-elle complète et en bon état ? Les contrôleurs se penchent également sur son harnachement, dont ils vérifient la propreté, le bon état et le confort. Du côté de la tête, on vérifie les réglages : un hackamore trop bas sur le nez, un mors qui pince les commissures contre la muserolle ou le licol, etc. Il ne faut pas oublier que les cavaliers d'extérieur sont souvent des indépendants, qui ne bénéficient d'aucune formation spécifique (même si certains ont monté en club : je peux le témoigner... galop 7 en poche, je file en extérieur ! Je ne suis quand même pas un cas, heureusement !).
Le cavalier doit être équipé pour se signaler en cas de retour nocturne et posséder une torche, une lampe cycliste bicolore pour les étriers, des bandes réfléchissantes pour les membres du cheval. Attention, le jury prend soin de vérifier que les lampes fonctionnent ! Tant qu'à faire, vérifier les piles... Une trousse de maréchalerie (mailloche, tricoise, râpe, rogne-pied) est indispensable, ainsi que des clous et des fers à la taille du cheval ou une sandale de dépannage. Autre élément volumineux : une boîte de secourisme qui doit contenir de quoi répondre aux besoins éventuels de l'homme et de l'animal. Premiers soins pour soigner une plaie, un coup, une piqûre d'insecte ou des affections les plus fréquentes chez le cheval. Le tout doit être propre, bien rangé, non périmé.
En TREC le règlement impose de
conserver la même embouchure d'un bout à l'autre de la compétition,
ce qui oblige le cavalier à un choix délicat. Il lui faut
trouver le harnachement qui lui permettra une conduite facile d'une main
pour le POR , une parfaite précision pour les allures et les franchissements
délicats du PTV, ainsi qu'un contact franc pour aborder les sauts
éventuels. Le compromis est difficile et dépend de la sensibilité
de sa monture. Certains concurrents résolvent le problème
en choisissant un mors sur lequel les rênes pourront, selon l'épreuve,
être fixées différemment (type mors espagnol très
prisé en TREC). On n'oubliera pas de laisser le licol et la longe
sous le filet ainsi que de prendre une corde d'attache, soit dans les sacoches,
soit accrochée à la selle.
En ce qui concerne la selle, elle doit elle aussi être identique pour les trois épreuves. Elle doit concilier des impératifs variés : grande surface de matelassure pour bien répartir le poids du cavalier et du paquetage, dés de fixation, pommeau discret et taquets de genoux pour faciliter le saut d'obstacles, assise confortable pour limiter la fatigue du POR. Il existe des modèles spécialement étudiés pour le TREC qui se révèlent être également d'excellentes selles de randonnée.
II- POR : parcours d'orientation et de régularité
C'est l'épreuve reine du TREC, qui
joue un rôle déterminant dans le classement. Le jeu consiste
à recopier avec précision un tracé sur carte, de 20
à 60 km, puis à le suivre avec exactitude pour découvrir
les contrôles dissimulés le long de l'itinéraire. Une très belle ballade en perspective, mais
qui réclame une attention soutenue : non seulement le cavalier doit
déjouer les subtilités de la typographie mais, de plus, il
lui faut respecter des vitesses imposées comprises entre 6 et 12
km/h. Pendant toute la durée du premier tronçon, il doit s'efforcer
de respecter cette vitesse moyenne sans prendre de retard ni d'avance, jusqu'au
premier contrôle, dont il ignore évidemment l'emplacement.
Lorsqu'il franchit les fanions, les contrôleurs relèvent son
temps d'arrivée, qu'ils arrondissent à la minute affichée.
Ils l'inscrivent sur son carnet de route. Le temps effectué est comparé
au temps idéal que le traceur calcule à partir de la vitesse
imposée. Chaque minute de décalage coûte deux points
de pénalité. A chaque contrôle, une nouvelle vitesse
est indiquée par affichage pour le tronçon suivant.
La première chose qui compte c'est
de bien connaître les allures de son cheval : savoir qu'au pas il
va à environ 7,5 km/h, au petit trot à 11 km/h. Ce sont des
mesures à effectuer chez soi sur un tronçon d'environ 500
m avec un chronomètre pour plus de précisions.
Pour ne pas prendre de retard, la meilleure solution consiste à anticiper : ne pas attendre d'arriver à un carrefour pour réfléchir au prochain changement de direction. Un examen minutieux de la carte et du chrono permettent de se préparer. Quand tous les indices sont clairs, on peut facilement se concentrer ! Il est parfois judicieux de prendre quelques minutes d'avance, quand l'itinéraire ne présente aucune difficulté, en prévision d'une grimpée, d'un sous-bois ou d'un bout de tracé douteux ! Car l'important n'est pas d'arriver au contrôle à l'heure mais d'arriver au contrôle en ayant pris le bon chemin (et à l'heure aussi c'est mieux...).
III- Maîtrise des allures : du dressage en ligne droite
La troisième étape se déroule
dans un couloir un peu mystérieux tracé à la chaux
dans un vaste pré : 1,50 m de large, 150 m de long. Les concurrents
s'y lancent tour à tour, sous l'oeil vigilant de contrôleurs
disséminés le long de la piste. Il s'agit d'abord de parcourir
celle-ci au galop lent, puis de revenir au pas rapide. un barème
définit le nombre de points gagnés qui sont fonction du temps
réalisé dans chaque allure. Il suffit d'une malheureuse foulée
de trot ou d'un pied posé hors du couloir pour perdre ce précieux
capital.
Le chemin est semé d'embûches pour le pas rapide : la piste, le cheval vient de la parcourir dans l'autre sens au galop lent, ce qui lui a réchauffé les idées, ce qui ajoute la difficulté psychologique de l'épreuve et augmente le risque de trottinement. N'oublions pas que la veille, le cheval a fourni un gros effort sur l'épreuve d'orientation, dont il garde peut-être quelques courbatures. Dernier écueil possible, la dégradation du terrain : lorsqu'une trentaine de chevaux sont déjà passés, la piste finit par accuser des irrégularités ou devient glissante. Autant de bons prétextes pour une faute...
IV- PTV : parcours en terrain varié
Même s'il est l'affaire de quelques courtes minutes pour le concurrent, le PTV représente le moment le plus intense de la compétition. Un point de vue partagé par le public, qui suit toujours son déroulement avec beaucoup d'intérêt. Conçu comme un résumé des aléas de la randonnée, le PTV regroupe toutes les difficultés de dressage et d'éducation qui attendent le cavalier d'extérieur.
Généralement proposé
le dimanche après-midi en dernière épreuve, le PTV
constitue un spectacle très apprécié du public. Les
cavaliers partent les uns après les autres à quelques minutes
d'intervalle, pour ce parcours de moins de 5 km qui rassemble un concentré
de difficultés inspirées de la randonnée. Le rythme
est soutenu : un temps idéal à ne pas dépasser oblige
le cavalier à ne pas traîner entre deux franchissements. Une
minute de retard coûte 5 points, ce qui n'est pas négligeable.
Les concurrents ont reconnu le parcours à pied avant l'épreuve,
soit individuellement, soit sous la conduite du traceur qui a précisé
les consignes et donné quelques conseils.
Le parcours comporte en général 16 difficultés, réparties sur tout sa longueur. Certaines, comme le montoir ou l'immobilité libre, peuvent être proposées hors-temps, en début ou en fin de tour. L'entrée et la sortie de chaque difficulté sont balisées par des fanions de couleur, rouge à droite, blanc à gauche. Une zone de pénalité peut être matérialisée (par exemple à la chaux) autour du franchissement pour indiquer jusqu'où les pénalités de refus ou de chute s'appliquent. Sur le parcours, on peut également trouver des passages obligatoires signalés par des fanions. A noter que toute erreur de parcours est éliminatoire. Si le cavalier ne souhaite pas franchir l'une des difficultés, ce qui est son droit, il doit cependant se présenter devant, et communiquer sa décision au jury. Il obtiendra la note 0 pour cette difficulté mais ne sera pas éliminé.
Chaque franchissement se fait en effet
sous l'oeil d'un jury qui attribue une note sur 10. Les critères de notations sont spécifiques à
chaque difficulté : à chaque fois, 7 points sont accordés
pour l'efficacité, toute faute (refus, barre tombée, rupture
d'allure imposée) coûtant 3 points. Si ce premier score est
positif, la note de style (de +3 à -2) viendra s'y ajouter ou s'y
retrancher. Elle évalue la finesse des intervention du cavalier,
sa position, l'harmonie du couple. Mais, sur certaines difficultés,
elle peut sanctionner seulement un point précis, par exemple, l'allure
de franchissement (bordure maraîchère, slalom, par exemple).
Notez qu'une pénalité de 3 points est retenue en cas de brutalité
ou de franchissement dangereux.
L'éventail des difficultés n'étant pas très étendu, les traceurs du PTV peuvent corser la difficulté en proposant des associations difficiles : placer une bordure maraîchère quelques mètres après des branches basses ; demander un reculer après une longue galopade ; faire enchaîner contre-bas et contre-haut ou inversement ; choisir une montée en main précédée d'un petit fossé qui incitera le cheval à s'élancer et à précéder son cavalier ; placer des ânes ou des chèvres à côté du portail pour détourner son attention... Ces raffinements constituent autant de défis pour les cavaliers expérimentés aux montures bien dressées, loin de la routine des parcours standardisés.
V- Choix du cheval de TREC
Le TREC exige du cheval des qualités
sportives variées, des performances d'exception. Le POR met à
rude épreuve la capacité des chevaux à parcourir de
longues distances. Même si les vitesses et le kilométrage peuvent
paraître modestes par rapport à ce qui est exigé en
endurance, la performance, compte tenu des nombreux changements de rythme,
est notable. En outre, le cheval doit avoir parfaitement récupéré
le lendemain, souplesse et décontraction étant nécessaires
pour les allures et le PTV. Un cheval peu grand, massif, aux membres solides,
avec du sang, conviendra mieux qu'un cheval lourd ou qu'un poney rond, qui
risquent d'avoir du mal à tenir le rythme et de souffrir en fin de
parcours.
Bien sûr, le galop rassemblé peut s'acquérir à force de travail. Mais le cavalier d'extérieur ne dispose pas toujours d'une carrière, ni des connaissances ou des conseils qui l'aideraient à atteindre cet objectif. Autant choisir un partenaire présentant déjà, dans cette allure, une certaine aisance. En ce qui concerne le pas, les prédispositions du cheval jouent un rôle essentiel : il faut s'assurer qu'il se méjuge et qu'il se déplace avec énergie dans l'allure, mais sans trop trottiner. Un bon pas est également un atout sur le parcours d'orientation.
De plus, rares sont les chevaux d'extérieurs doués pour le saut ! Les bons sauteurs sont généralement orientés vers le concours hippique, non vers la rando ! Or, les obstacles de TREC peuvent se révéler assez impressionnants, surtout si l'on monte un cheval peu adroit, qui manque de style et d'équilibre.
Pour rester calme et concentré,
le cavalier doit pouvoir compter sur sa monture. Impossible de se pencher sur sa carte s'il faut retenir un cheval
affolé par l'éloignement de ses congénères,
qui hennit pour les appeler, chauffe et trottine pour les rattraper. Certains
chevaux sont plus indépendants que d'autres et sont donc un atout
de taille pour le POR.
Bien des difficultés du PTV obligent le cheval à surmonter son appréhension : franchissement de l'eau, d'un pont, d'un fossé. Sur le parcours d'orientation, il est également infiniment plus agréable de disposer d'un compagnon hardi, qui ne vous ballotte pas sans cesse d'écarts en coups de freins. Préférez donc une monture peu craintive. Sachez toutefois qu'un entraînement bien mené peut réellement métamorphoser un cheval. A vous de jouer !!!











